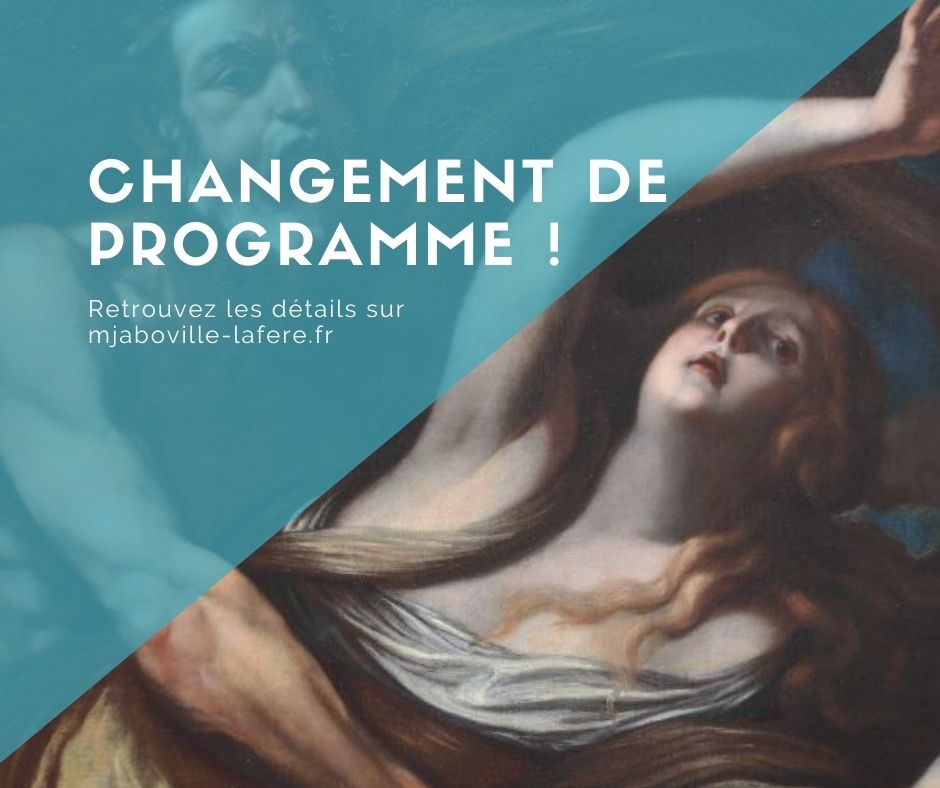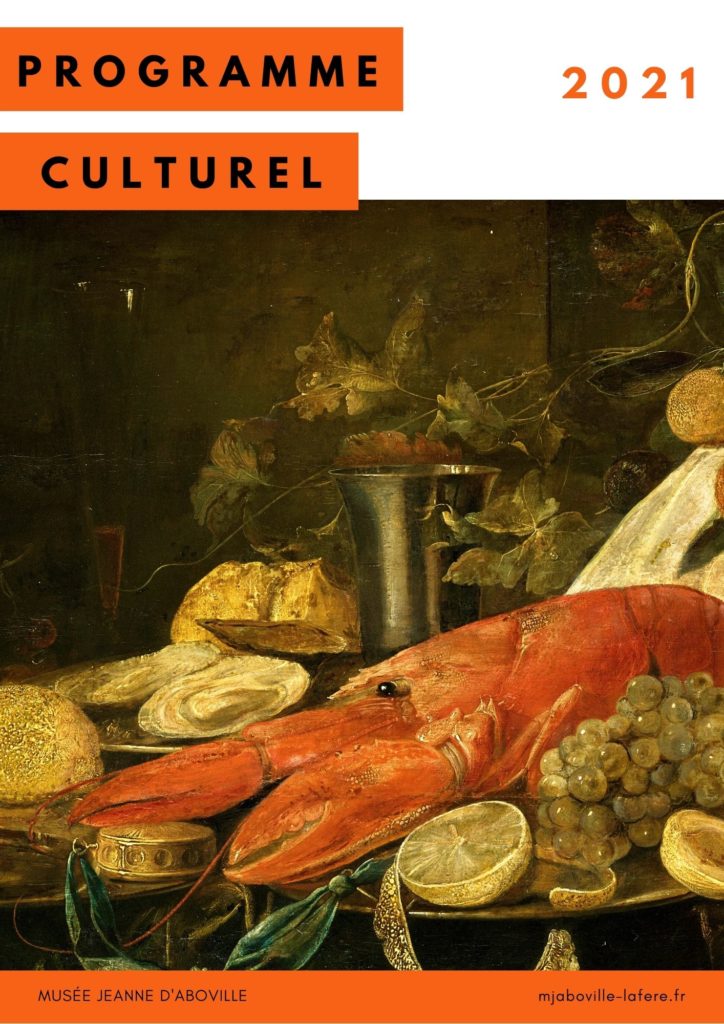Le détail du mois de mars provient d’un tableau flamand Les vierges sages et les vierges folles, œuvre de Martin de Vos. Né en 1532 à Anvers, où il meurt le 4 décembre 1603, Martin de Vos se spécialise dans les sujets religieux, allégoriques, historiques et de portraits, qu’il mêle fréquemment.
Comme nombre de peintres de son temps, il s’est rendu en Italie où il a résidé entre 1550 et 1558. Après ce voyage, Martin de Vos se définit comme un Romaniste, terme qui désigne les artistes étrangers, et plus particulièrement les artistes nordiques, ayant étudié et travaillé à Rome au XVIe siècle. L’œuvre de De Vos montre une forte influence des couleurs des Vénitiens : il aurait en particulier travaillé dans l’atelier du Tintoret à Venise qui l’initie à l’art maniériste. Le maniérisme se caractérise par des lignes sinueuses et un allongement totalement exagéré des corps, dont ce détail présente un bel exemple avec la silhouette portant une robe rose et bleue.
Ce tableau représente la parabole des dix vierges, que l’on trouve dans l’Evangile selon Mathieu : on y voit dix fiancées qui attendent leur époux, éclairées par des lampes : cinq vierges sages ont pris de l’huile pour alimenter leur lampe, symbolisant la Foi ou les Vertus en fonction des interprétations des exégètes, cinq autres vierges n’ont pas pris d’huile pour leur lampe et se retrouvent perdues dans l‘obscurité. On voit sur le détail les cinq vierges sages qui, éclairées par leur lampe, trouvent la porte du banquet de mariage, et sont accueillies par l’Epoux, symbolisant un mariage spirituel avec Dieu ou son Eglise.
Vous pourrez découvrir le reste du tableau à la réouverture du musée dans la salle consacrée aux peintres anversois !