Retour de restauration pour Saint Acace !

Après plusieurs mois de restauration, Saint Acace et les dix mille martyrs est revenu de restauration.
Passé entre les mains de deux restaurateurs, respectivement pour le support bois et le la couche picturale, Saint Acace révèle ses couleurs originelles et a pansé les plaies laissées par les affres du temps, et parfois les restaurations précédentes.
La restauratrice spécialiste du support bois Juliette Mertens est intervenu par la dépose de deux traverses ajoutées au dos et le retrait de pièces de bois plantées dans le panneau qui causaient des fentes dans le bois.
Les fentes ont été colmatées pour permettre le travail du restaurateur de la couche picturale, Igor Kozak, qui a procédé à un nettoyage de la couche picturale en retirant les repeints des précédentes restaurations et en enlevant le vernis oxydé.
Ce tableau a fait l’objet de recherches par l’équipe de l’Institut national de l’Histoire de l’art, sous la direction de la Conservatrice et Historienne de l’art Isabelle Dubois-Brinkmann, dans le cadre d’un Répertoire des peintures germaniques dans les collections françaises (1300-1550). Il sera présenté au musée de Besançon à l’été 2024 pour une exposition consacrée aux Trésors du Saint Empire. En attendant, vous pouvez le redécouvrir au musée Jeanne d’Aboville à partir du 3 janvier !
La visite de Noël
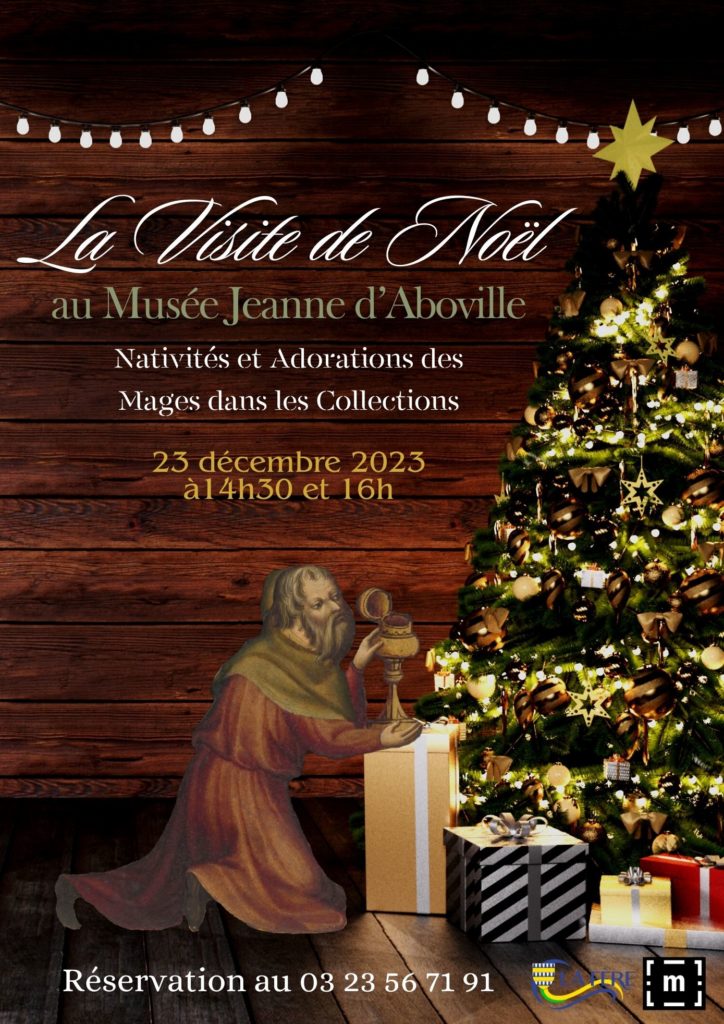
Le 23 décembre, le musée Jeanne d’Aboville vous propose une visite thématique inédite sur les représentations de la nativité et de l’adoration des mages dans les collections du musée. Ces thèmes religieux vont inspirer les artistes durant plusieurs siècles et connaitre des réinterprétations et des ajouts témoignant des mœurs de l’époque et des aspirations de leurs auteurs. Ils s’enrichissent d’éléments folkloriques puisés dans des récits merveilleux et des textes apocryphes, tels le bœuf et l’âne de la crèche, pas du tout mentionnés dans les évangiles !
Cette visite sera l’occasion de découvrir des tableaux inédits des réserves, ainsi qu’un triptyque flamand tout juste restauré et présenté de nouveau au public à cette occasion.
Infos pratiques :
La visite de Noël au musée Jeanne d’Aboville
Deux séances proposées le 23 décembre 2023, à14h30, puis 16h.
Durée : environ 40 mn
Tarifs : 4€
Réservation conseillée auprès du musée au 03 23 56 71 91.
Bonne fête de la sainte Barbe !
A l’occasion de la Sainte Barbe aujourd’hui, voici une peinture des réserves représentant la sainte martyre.

Cette œuvre de par son élégance et sa délicatesse nous laisse supposer qu’elle fut réalisée au cours du XVIIe siècle par un peintre actif à Rome.
Sainte Barbe est une vierge martyre du IIIe siècle ayant vécu en Asie Mineure. Elle est la fille de Dioscore, un riche édile païen. Lors de l’un de ces voyages et afin de garder intact la pureté de Barbe, il prit la décision d’enfermer sa fille dans une tour à deux fenêtres. Durant ce périple, Barbe reçu le premier sacrement prodigué par son percepteur Origène. Afin de manifester sa foi, elle perça une troisième fenêtre qui symbolise avec les deux autres la Trinité. A son retour de voyage, son père se rend compte de la conversion de sa fille au Christianisme. Furieux, il mit le feu à la tour mais Barbe réussi à s’échapper. Dénoncée par un berger mal-attentionné, son père la traîna devant le gouverneur romain Marcien qui la condamna à de nombreux supplices afin d’abjurer sa foi. N’y parvenant pas, il demande à Dioscore de décapiter sa fille mais la foudre le frappa quelques instants plus tard le tuant sur le coup.
Sainte Barbe est souvent représentée devant une tour comme ici au second plan.
La palme que tient la sainte est un second attribut, symbole du martyr qui symbolise la victoire sur la mort et le mal.
Ce tableau a pour particularité d’être peint sur du cuivre. Pratique qui connait son apogée entre le XVIe et le XVIIIe siècle, sa conservation est plus facile en raison de sa relative inertie. Le cuivre n’absorbant pas la peinture, les tons sont plus riches et les couleurs saturées. Cette technique permet de peindre des détails minutieux et ainsi donner un caractère précieux à l’œuvre.
Détail du mois de décembre : contraste, guerre napoléonienne et vaches…

Le détail du mois vous présente une œuvre attribuée à Petrus Gerardus van Os (1776-1839) représentant un berger et son troupeau dans un paysage. Van Os est un peintre de La Haye, formé par son père lui-même peintre et spécialiste des natures-mortes. Il suit les pas de son père après un passage dans l’armée (il participe notamment au siège de Naarden pendant les Guerres napoléoniennes), et devient professeur de dessin jusqu’à sa mort. II s’est exercé dans tous les genres et dans toutes les disciplines, passant de la peinture à l’aquarelle, la gravure, la lithographie ou la miniature.
Petrus Gerardus van Os appréciait dans son travail les effets de lumière contrastés. Ici il renforce tout particulièrement cet effet en faisant se côtoyer une vache blanche et une vache noire. L’attention au détail se perçoit dans l’ombre portée de la corne de la seconde vache. Une autre caractéristique de son travail est le rendu naturaliste des animaux, typique des peintres tardifs de La Haye, soucieux de rendre les anatomies et les volumes avec exactitudes.
Ce tableau provient des réserves et n’est actuellement pas visible dans l’exposition permanente mais d’autres œuvres représentant des paysages animés sont bien sûr exposées au musée. On vous propose même de revenir sur le rôle du bœuf de la crèche de Noël à l’occasion de la visite du 23 décembre !
Bonne fête à toutes les Catherine !
En ce 25 novembre, nous fêtons les Catherine, en référence à la figure de Sainte Catherine d’Alexandrie.
Vierge et martyre qui aurait vécu aux IIIe et IVe siècles en Egypte, son culte fut très populaire au Moyen-Age, importé en Occident par les Croisés. Sa fête donne maintenant lieu à diverses célébrations populaires, dont celles des jeunes filles à marier, appelées les Catherinettes. Cette fête religieuse a disparu du calendrier romain en 1969, « en raison du caractère fabuleux de sa passion » et du doute qui pèse sur l’existence même de la sainte. Le thème inspira de nombreux peintres de la Renaissance italienne. Le musée possède plusieurs exemples intéressants présentant le moment de la vie de la sainte le plus intense, celui de son mariage mystique avec Jésus.
La légende de sainte Catherine d’Alexandrie
Cette légende nous est connue principalement par la Légende dorée de Jacques de Voragine.
Catherine serait née vers 290 dans une famille noble d’Alexandrie et reçoit une éducation soignée. Un jour, elle voit une séance d’apostasie (abandon et reniement de sa foi) de Chrétiens organisée par l’empereur Maxence ; elle s’adresse à lui et argumente dans un débat contre lui de façon remarquable où elle tente de convaincre l’empereur de l’existence du dieu unique des Chrétiens. Celui-ci constatant qu’il ne pourrait trouver de parade à la sagesse de Catherine convoque une assemblée de cinquante doctes grammairiens et rhéteurs.
Catherine, encouragée par un ange du Seigneur lui recommandant de résister avec constance, s’adresse à l’empereur devant les orateurs puis elle réussit à les faire taire par la pertinence de son argumentation, et à les convertir. L’empereur les fait aussitôt brûler au milieu de la cité. Séduit par sa jeunesse et son « incroyable beauté » l’Empereur lui propose une place dans son palais, en second rang après la reine. Elle répond : « Cesse de tenir de tels propos. Je me suis donnée comme épouse au Christ. Rien ne pourra m’éloigner de l’amour que j’ai pour lui. ». L’empereur la fait alors dévêtir, frapper à coups de croc de fer, et jeter dans une prison obscure sans alimentation pendant douze jours.
Le Christ envoie une colombe blanche qui nourrit la prisonnière « d’un aliment céleste ». À son retour, l’empereur lui propose une nouvelle fois d’être sa compagne, ce qu’elle refuse à nouveau. Un préfet conseille alors au roi un supplice féroce pour la vierge afin d’effrayer les autres Chrétiens. Quatre roues entourées de scies de fer et de clous doivent lui déchirer et broyer le corps. Alors Catherine pria le Seigneur de détruire cette machine. « Et voilà qu’un ange du Seigneur frappa et brisa cette meule avec tant de force qu’il tua quatre mille païens. »
L’empereur propose une dernière fois à Catherine de devenir son épouse. Elle refuse encore et il la condamne à être décapitée. Quand elle est conduite au lieu d’exécution, elle prie Dieu puis, quand elle est décapitée, du lait jaillit de son cou en guise de sang.
Alors des anges prennent son corps, l’emportent jusqu’au mont Sinaï, et l’ensevelissent avec beaucoup d’honneurs jusqu’à sa redécouverte au VIIIe siècle par des moines établis sur le Mont.
Sainte Catherine au musée
Le musée possède plusieurs représentations du mariage mystique de la sainte, en voici deux exemples puisés dans les collections italiennes :

Mariage Mystique de sainte Catherine
Biagio Pupini, dit Biagio delle Lame
(Bologne, actif 1511 – après 1575)
Peintre principalement actif à Bologne, il plane plusieurs zones d’ombre sur la vie de Biagio delle Lame. On lui connait néanmoins de nombreuses collaborations avec d’autres artistes et une place importante au sein de la guilde des peintres et sculpteurs de sa ville natale.
Si les visages et les mains aux longs doigts évoquent l’influence du peintre Le Parmesan, les figures ont surtout ici un usage symbolique, sainte Catherine, l’enfant Jésus et enfin saint Joseph, voient leurs têtes alignées dans une évocation des trois âges de la vie.
Le moment que présente le tableau est donc le mariage mystique avec le Christ, puisque Catherine a déclaré qu’elle lui était destinée. Il s’agit d’une élévation spirituelle, qui atteint une forme d’union avec le Christ assimilable à un mariage. Celui-ci est symbolisé par l’anneau que Jésus lui présente.

Mariage mystique de sainte Catherine
Girolamo da Santa Croce
(Santacroce, 1480 – Venise 1556)
Peintre vénitien du XVIe siècle, Girolamo fut un élève de Giovanni Bellini par lequel il acquit la maitrise du style Renaissance. S’il travailla principalement dans et autour de Venise, on trouve également trace de son oeuvre en Dalmatie, notamment un retable situé à l’église paroissiale de Blato (Croatie).
On voit généralement transparaitre dans les oeuvres de ce peintre l’influence de Bellini, dans ce tableau, on remarque plutôt sa volonté de se placer en suiveur d’un autre grand maitre vénitien en la personne de Titien. L’intégration de détails est inspirée des scènes pastorales de celui-ci : la vieille femme juchée sur sa mule à gauche et le vacher à droite, tous deux placés dans le paysage, créent un climat évocateur qui répond à l’aspect verdoyant de l’ensemble.
Les figures principales, la Vierge à l’enfant et Sainte Catherine, semblent quant à elles inspirées de travaux familiaux, Girolamo venant d’une famille de peintres bergamasques. Elles s’inscrivent dans un cadre représentatif typiquement vénitien.
Détail du mois de novembre : ange, phylactère et vaisselle flamande…

Le détail du mois provient d’un triptyque de la salle des Primitifs représentant sur son panneau central une adoration des Mages réalisée par l’atelier anversois de Pieter Coecke van Aelst, actif dans la première moitié du XVIe siècle. Notre détail provient du volet gauche représentant l’Annonciation.
On y voit la représentation de Gabriel, l’ange de l’Annonciation qui désigne le ciel et déploie un phylactère. Un phylactère est un moyen graphique semblable à une petite banderole, sur laquelle se déploient les paroles prononcées par le personnage dépeint, ici on peut y lire Ave gratia plena, dominus tecum, soit « Je te salue, pleine de grâces, le Seigneur est avec toi ». L’ange est somptueusement vêtu et paré car les peintures de l’atelier de Pieter Coecke van Aelst était célèbre pour leurs détails décoratifs d’une certaine préciosité.
A l’arrière-plan, on peut voir de la vaisselle d’étain posée sur une armoire, que l’on s’attend davantage à retrouver dans une maison bourgeoise des Flandres que dans l’habitat de Marie en Palestine, les peintres interprètent alors le décor des scènes bibliques avec une grande liberté et les scènes de l’annonciation sont généralement l’occasion d’expérimentation sur la profondeur avec des jeux de perspectives.
Ce tableau était parti en restauration et revient au cours du mois de novembre et vous aurez l’occasion de le redécouvrir nettoyé et consolidé. En effet, on peut voir une fissure qui court dans le bois et dont l’état a nécessité une intervention des restaurateurs. A bientôt au musée pour le voir en entier !
L’instant Zen au musée
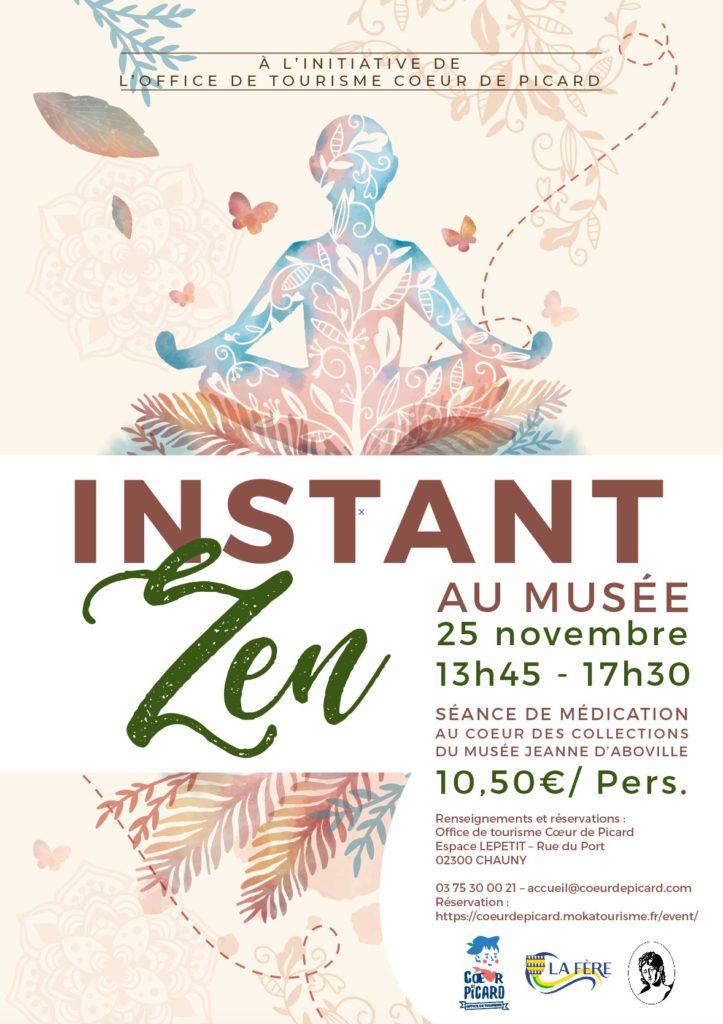
En novembre, l’Office de tourisme Coeur de Picard vous propose un rendez-vous inédit de Zénitude!
Il vous propose une séance de méditation au cœur des collections du Musée le samedi 25 novembre à 13h45.
Infos pratiques :
Tarif : 10,50€ par personne
Attention la réservation est obligatoire auprès de l’Office de tourisme Coeur de Picard. Vous pouvez trouver le lien pour aller vers la billetterie en cliquant ici.
Détail du mois d’octobre : Roi, chasse et lièvre…

Le détail du mois d’octobre est consacré à la représentation du roi sans doute le plus emblématique de l’histoire de France, Louis XIV ! Ici peint par l’atelier florissant d’Adam François van der Meulen (1632-1690), il témoigne du style baroque adopté par ce peintre, bruxellois d’origine mais entrée au service du roi de France en 1662. Spécialiste des chevaux et des paysages, il est célèbre pour ses scènes de chasse et de bataille : son talent est reconnu par le Roi en personne qui lui accorde une pension. Il accompagne Louis XIV dans tous ses voyages, dans toutes ses résidences, et dans toutes ses guerres.
Le détail ici présenté évoque un départ de chasse, Louis XIV est figuré sur un cheval blanc, vêtu d’un habit de chasse somptueux. La pratique de la chasse était alors un loisir réservé à la noblesse, qui en détenait le privilège. Le roi devait donc marquer son rang devant la cour en étant un chasseur assidu. Il s’agit alors de chasse à courre, et le roi va se déplacer accompagné d’un équipage de vénerie nombreux, pouvant atteindre trois-cents personnes ! On peut voir des nobles qui l’assistent à pied ou à cheval, à l’image du second cavalier sur le détail qui tient un lièvre par les pattes-arrières.
Pour découvrir cette œuvre magistrale en entier, une date à retenir : le 7 octobre prochain ! En effet le tableau sera dévoilé au public à l’issue de sa restauration lors de l’après-midi avec Louis XIV où restaurateurs et historiens vous en dévoileront tous les secrets !
Détail du mois : une abbaye, des nuages et beaucoup de talent…

Le détail du mois de septembre vous présente l’un des plus beaux paysages réalisés par Salomon Ruysdael (Naarden, vers 1600– Haarlem, 1670), un des grands maîtres de ce genre au XVIIe siècle. Spécialiste des paysages de rivières, d’estuaires ou de dunes, Salomon Ruysdael commence sa carrière à Haarlem et restera toute sa vie aux Pays-Bas. Oncle du célèbre Jacob van Ruisdael (Haarlem, 1628 – Amsterdam, 1682), il entreprend sa formation.
Ce détail est tout à fait typique de son style, avec les effets atmosphériques du ciel et le troupeau venant animer le paysage, mais il est surtout remarquable par la présence de ruines de deux édifices religieux. En effet, le bâtiment semi-détruit est identifié comme l’abbaye d’Egmond, ou abbaye Saint-Adalbert, un monastère bénédictin, situé en Hollande-Septentrionale. L’abbaye fut détruite en 1573, pendant la guerre des quatre-vingts ans qui voit les Hollandais lutter contre les Espagnols. L’abbaye sera laissée à l’état de ruines par les Gueux de mer, une milice hollandaise protestante de corsaires et d’aventuriers qui agit pour le compte de Guillaume d’Orange, le principal constructeur de l’indépendance néerlandaise. Le clocher de l’arrière-plan appartient, lui, à l’ancienne église paroissiale, la Buurkerk, du village voisin de Binnen.
Pour découvrir le reste du tableau, il faudra vous rendre au musée pour le voir parmi d’autres chefs-d’œuvre du Siècle d’Or hollandais. Pensez notamment au week-end des Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre, où le musée sera ouvert gratuitement le samedi et le dimanche de 10h à 17h30 !
